ACCUEIL
» PUBLICATIONS
» ANCIENS NUMEROS
» Les post- et les anthropologies en Afrique. Du dialogue sud/nord, numéro 2, volume 1, janvier 2019. Actes du colloque international de Libreville, du 14 au 15 juin 2018
» Articles de ce numéro
AN = Epistémologie et transgression.
E. Faber Mensah Ngoma,
Université Omar Bongo,
Département d’Anthropologie,
Laboratoire d’Anthropologie (LABAN),
Gabon
- L’anthropologie est sans doute parvenue, durant une période relativement longue à s’affirmer comme discipline académique, mais a-t-elle réellement réussi à se positionner objectivement vis-à-vis d’un Autre, d’une altérité clairement défini en tant que tel ?
La réflexion portant sur les « Post » donne l’occasion non pas d’apporter des réponses définitives à des questions complexes [1], d’ailleurs, une telle entreprise, s’il elle devrait en être menée, supposerait que soit définitivement clos le débat qui l’a fait émerger [2]. Il doit s’agir davantage, dans notre perspective, de continuer une discussion déjà ouverte au tour des années 2000, notamment avec la question postcoloniale. Il faut donc enrichir la discussion afin d’envisager des pistes solides et, pourquoi pas, des nouvelles avenues fiables pouvant, peu ou prou, permettre la possibilité d’une « autre » anthropologie, d’une anthropologie africaine assumée susceptible de proposer une autre manière de penser le terrain africain avec des outils (méthodologiques, théoriques et épistémologiques) correspondant à la spécificité de l’Afrique certes, mais pas dans une perspective autarcique.
Il n’est donc pas question ici – et c’est important de le signaler car la tentation est en règle générale souvent très grande – de créer un doublon de la discipline du simple fait de l’adjonction du qualificatif « africaine » qui constituerait une sorte de « label », mais un « label » plutôt vide puisque n’apportant rien de nouveau ni aux débats actuels, ni à la pratique de la discipline elle-même. D’autre part, on se préoccupe d’éviter d’être tenté et hanté tous azimuts par les « démons » d’un supposé affranchissement épistémologique parce que profondément déterminé par un relent revanchard [3].
Cette contribution, au contraire, se pose en alternative objectivement fondée, susceptible de « corriger » de manière constructive (dans l’opposition et la concession si nécessaire), ce qu’elle considère comme étant des erreurs, voire des errances d’une certaine « anthropologie universaliste ».
Son idée centrale est donc de considérer la spécificité (dans le présent cas, le terrain africain en général, et celui d’Afrique centrale en particulier), non plus comme une exception dénuée de toute capacité à offrir du sens dans un ensemble plus vaste puisque spécifique et idéologiquement assignée, mais plutôt d’intégrer la singularité anthropologique africaine dans une étendue des connaissances plus large parce qu’en réalité, elle en est consubstantielle. Comment en effet penser l’espace et le temps d’une société, ou plus largement comment envisager l’histoire et l’avenir d’un espace social donné en dehors de celui-ci ?
Si l’objet de la présente contribution n’est pas de répondre précisément et prioritairement à cette interrogation mais plutôt d’envisager la possibilité d’une autre anthropologie africaine, il reste qu’au XXIe siècle, et au regard des dynamiques de changement qui s’opèrent à vitesse grand « V », cette problématique a le mérite d’être posée ne serait-ce que pour susciter le débat. Notre réflexion portera sur les concepts en jeu, les éléments de base constitutifs d’une réflexion sur une anthropologie africaine assumée et ses fondements épistémologiques.
1. Les concepts et leurs définitions
Avant de poursuivre plus en profondeur cette discussion autour de la question essentielle du « terrain africain comme lieu d’expression d’une anthropologie africaine assumée », il nous paraît opportun de revenir sur la définition, sinon le sens de deux concepts qui surdéterminent le titre cette contribution. Celui de « transgression » d’une part et celui de « post » de l’autre (l’ordre revêt peu d’importance).
S’il est vrai que dans cette analyse l’usage de la notion de « transgression » adopte volontiers une posture, cette notion parce qu’elle est centrale dans le dispositif d’ordonnancement social, est davantage « porteuse » de sens qu’il n’y paraît. Considérée comme l’action de transgresser, c’est-à-dire de ne pas respecter une loi, un ordre ou un interdit par la plupart des dictionnaires disponibles, la définition d’un autre concept l’incluant proposée par Le Petit Robert (1990) permet en revanche d’en éclairer le sens, et partant d’en justifier les raisons de son choix. Il s’agit en effet du concept de déviance. La déviance, nous dit Le Petit Robert, est un mot d’usage très récent (les années 1960) qui, dans son sens psychologique, signifie « comportement qui échappe aux règles admises par la société ».
Plus précisément, est considéré comme « déviant(e) », toute personne dont le comportement s’écarte de la norme sociale admise. Ainsi, pour qu’une situation de déviance soit admise comme telle, il faut nécessairement que soient réunis trois éléments constitutifs de celle-ci. Il s’agit de :
- - l’existence d’une norme ;
- - un comportement de transgression de cette norme ;
- - un processus de stigmatisation de cette transgression.
Tout l’intérêt de la notion de « transgression », dans notre réflexion, réside finalement dans l’encadrement dont elle fait explicitement l’objet. La norme, conçue pour régir le social ne peut se concevoir en dehors de la transgression. On s’en rend donc compte, cette norme porte en elle, dès les origines, le germe même de la transgression, donc du risque de sa remise en cause. Si la norme, et en l’occurrence la norme sociale, est indispensable pour une société, la nécessaire transgression qui n’est pas une apologie de l’anarchie ou du chaos l’anticipe finalement.
C’est parce que la norme est, dans la plupart des cas, idéologiquement marquée qu’elle porte en elle les germes de sa propre dérive. La transgression apparaît de ce point de vue comme un rempart. Ce n’est donc pas surprenant qu’en se posant comme la garante d’un certain ordre social, la norme se prémunie d’un dispositif censé juguler toute action de transgression notamment par un processus efficace de stigmatisation. Sans chercher à davantage s’étendre sur le développement des arguments évoqués et se rapportant à la notion de transgression, signalons encore que, de même que la société procède par la norme et donc par son respect pour assurer son bon fonctionnement, la science qui n’est pas idéologiquement neutre en fait autant. Ainsi, la « transgression » méthodologique, théorique et épistémologique apparaît en définitive comme un rempart sûr à l’expression idéologique, à l’unilatéralisme scientifique et à l’offre épistémologique disponible. Notre titre ne porte pas une posture sarcastique mais scientifique. Dans ces conditions, on le sait, il ne peut être exempt de perspective idéologique d’autant que l’idée de neutralité dans la pratique scientifique est davantage un projet qu’une réalité.
En outre, pour Le Petit Robert (op. cit.), le terme « Post », tiré du latin, est littéralement rendu par l’adverbe de temps et de lieu [4] « après » (précision non fortuite) pour signifier aussi bien le temps et l’espace. Pour notre part, cette notion de « Post » se réfère davantage à l’idée du moment postcolonial tel qu’envisagée par les études postcoloniales, c’est-à-dire dans une double assertion. Il s’agit donc d’une part, de considérer la période qui succède au moment colonial et dont les indépendances constituent en quelque sorte la charnière et, d’autre part, de considérer ce concept de « Post » comme l’ensemble des faits qui procèdent du fait colonial et dont les effets demeurent perceptibles jusqu’à nos jours. Cette perspective dépasse la définition du Petit Robert qui elle ne retient du terme « Post » que les seuls aspects de lieu et de temps. En revanche, elle fait écho aux propos d’Homi Bhabha. Pour lui, la notion ne recouvre aucunement la séquentialité (après le colonial) ou la polarité (anti-colonial), à tout le moins, pas exclusivement.
Notre approche doit ainsi prendre en compte toutes les phases du processus colonial qui jusqu’à date font sens. Comme l’indique fort brillamment Laetitia Zecchini en réponse justement à l’ouvrage au titre révélateur de Jean-François Bayart paru chez Karthala (2010), « Les études postcoloniales postulent que l’indépendance ne suffit pas à occulter les traces de la domination coloniale et que celle-ci, selon l’articulation foucaldienne savoir-pouvoir, reposait certes sur une infrastructure militaire mais aussi sur tout un appareil de savoir. C’est donc l’analyse discursive, le décentrement et la déterritorialisation des discours, mais aussi leur « « revers », ce qui s’y dérobe, s’y joue et s’y pluralise qui est en jeu » (2011, 27). En toile de fond, cette idée de domination dans les rapports « nord-sud » va structurer la présente communication.
2. Eléments de réflexion pour les bases d’une anthropologie assumée
Deux exemples tirés de situations différentes peuvent permettre d’illustrer l’idée du risque épistémologique à prendre corrélativement à la pratique des sciences humaines et sociales en Afrique. Le premier exemple, nous le tirons du monde militaire. Imaginons un Etat nouvellement indépendant. La sécurité à l’intérieur et à l’extérieur de ses frontières est en règle générale l’un des ses premiers chantiers. C’est donc à ce titre qu’il se tournera vers un Etat (ancienne puissance dominatrice ou non) militairement reconnu pour structurer son armée (formation des troupes, des sous-officiers et officiers, en usage et maniement des armes et munitions, des équipements etc.). Ainsi, la défense du territoire national, comme la sécurité intérieure du nouvel Etat, repose exclusivement sur un dispositif (des logiques et des équipements) qui leur sont totalement extérieurs, puisque mises au point par une puissance dont il reconnaît en définitive l’expertise.
Dans le même ordre d’idée, comment imaginer la propre défense intérieure de ce même Etat, s’il venait à surgir un différend de quelle que nature que ce soit qui l’opposerait à son ancienne puissance formatrice ; différend si insurmontable de telle sorte que seul le conflit armé en soit l’unique solution de continuité ? Dans tous les cas et dans la mesure où la logique militaire, la formation des troupes, le dispositif opérationnel (armes munitions et matériels motorisés, etc.) demeurent l’apanage exclusif de cette dernière puissance, l’issue ne fera aucun doute. C’est la puissance devenue tutélaire par la force des choses qui aura nécessairement et malheureusement l’ascendant et donc le dernier mot, car maîtrisant à la perfection tous les éléments non seulement du dispositif armé, mais également les logiques et la technologie qui les sous-tendent et en organisent les dispositifs [5].
Le deuxième exemple tiré du domaine biomédical nous plonge dans un processus subtil mais très efficace d’externalisation [6], voire d’exclusion stricte des structures des « savoirs locaux » du champ et des objets de santé. En effet, à travers la mise en place d’un dispositif à la fois verrouillé – de bout en bout – et hautement sophistiqué, l’ordre biomédical s’assure une gestion exclusive de l’événement-maladie, quand bien même celui-ci se manifeste en dehors de son univers sociogéographique. Si l’ordre des médecins présenté comme étant une structure professionnelle, administrative et juridique veille à la défense et la régulation de la profession médicale, ses différentes missions ne s’exercent en revanche qu’à l’intérieur d’un environnement exclusif, avec des règles qui ne s’appliquent qu’à ceux qui y font partie et qui ont préalablement rempli des critères bien définis : il s’agit de la seule biomédecine [7]. Notons ce fait important : dans cette organisation [8], en dehors de cette sphère singulière, toute autre structure (médecine africain par exemple), bien que prenant en charge elle aussi l’événement-maladie, ne peut être considérée comme pertinente. Elle peut tout juste être tolérée. Devant la puissance d’un tel arsenal dont la puissance est tout à la fois structurelle, financière, technique et technologique, l’issue du face à face ne fait aucun doute. On assiste simplement à l’adhésion [9], sans autres formes de procès, à l’offre biomédicale finalement « imposée ».
La principale conséquence d’une telle capitulation, lorsqu’on considère les éléments constitutifs du dispositif mis en place (formation, structure de formation, les moyens dégagés les techniques et technologies proposé), est comme on l’a vu pour le premier exemple, la subordination quasi-totale des structures locales chargée de la gestion de l’événement-maladie, aussi bien aux dispositifs biomédicales qu’aux logiques que ceux-ci sous-tendent. Pour mieux rendre compte de cet assujettissement des structure thérapeutiques locales aux structures biomédicales, observons leur comportement : n’assiste-t-on pas impuissant à une sorte de syncrétisme tous azimuts dans ce domaine particulier, comme c’est d’ailleurs le cas en ce qui concerne la religion ? Le nganga [10], tirant d’ailleurs et de plus en plus sa légitimité de la maîtrise de l’écriture, privilégie le port de la blouse blanche et l’usage et la technique du stéthoscope ou du tensiomètre, tente de ressembler à son homologue de la biomédecine.
On pourrait rétorquer avec R. Devisch que ces structures locales se réapproprient, sous un mode ironiquement mimétique, certaines formes de violences caractéristiques du système de pouvoir, du discours et des symboles de base de l’époque coloniale ou postcoloniale ; et qu’ainsi elles renouent en même temps de façon créatrice avec les configurations culturelles ancestrales, signe d’une aspiration à un affranchissement, à une libération à l’égard des modèles chrétiens qui inventent un ordre social et culturel tout à fait « nouveau » (1996, 91). Le fait est que ces structures locales restent, et peut-être même pour un bon moment encore, soumises, ne serait-ce qu’à travers ces images qu’elles se réapproprient, aux règles de fonctionnement du dispositif ainsi mimé.
Or, on le voit bien, en intégrant des éléments techniques et technologiques du dispositif biomédical dans les dispositifs locaux de prise en en charge de la maladie, ce ne sont pas que des techniques et des technologies qui sont réinterprétées, c’est d’abord et avant tout des logiques de fonctionnements exogènes qui sont intégrées au cœur même du dispositif local. De ce point de vue, comment espérer continuer à détenir le contrôle de la gestion de l’événement-maladie ? Rappelons qu’il est de notoriété que les systèmes d’interprétation, évidemment manié par des spécialistes (nganga entre autres) mais connus ou à tout le moins reconnus de tous, font en effet de tout désordre biologique (survenue d’un dysfonctionnement physiologique ou psychiatrique), le signe d’un désordre social tel que l’agression en sorcellerie, l’adultère ou la rupture d’un interdit. Et que par ailleurs, une même logique intellectuelle commande la mise en ordre biologique et la mise en ordre sociale.
Ce qui revient à dire que dans une société donnée, une seule grille d’interprétation du monde s’applique tout autant au corps individuel qu’aux institutions sociales. Autrement dit, si logique il y a, elle est celle-là même dont procèdent simultanément la constitution du corps et l’institution du social (M. Augé, 2009, 35 - 36). Toute chose qui perd tout son sens dès lors que les logiques qui fondent le dispositif local de prise en charge de l’événement-maladie se diluent dans celles qu’elles intègrent par mimétisme ou par syncrétisme. Comment dans ce cas imaginer une autonomisation réelle de structures locales si celles-ci sont noyées, phagocytés par des structures ayant une organisation extrêmement forte et donc redoutable ? C’est dans cette perspective que s’exprime ce que nous avons précédemment nommé externalisation des structures de « savoirs locaux » de leur champ et des objets qu’ils renferment (société, santé, maladie et médecine).
En effet, comment penser le local, en l’occurrence, l’objet maladie et son corollaire social avec des outils qui lui sont totalement extérieurs, et espérer en avoir la totale maîtrise ? Poser cette interrogation, c’est en partie y répondre. Car en l’état, qu’il s’agisse de prise en charge purement thérapeutique ou encore des études sur les objets se référant à la maladie, à la médecine ou plus globalement à la santé en Afrique, et singulièrement en Afrique centrale, les dispositifs mobilisés, à l’exception de cas très marginaux, sont dans leur essence de même nature que les pratiques exclusivement extérieures au continent.
Ces exemples tirés de domaines différents (armée et santé) ont partie liée au fait que des enjeux complexes de pouvoir qui s’y déroulent renseignent fortement sur les risques et les conséquences encourus par toute « structure locale » ayant à charge la gestion d’une ou plusieurs parcelles de souveraineté. En effet si les structures locales devaient, pour des raisons d’efficacité ou d’opérationnalité, céder ou concéder à un moment ou à une autre leur fonctionnement à toute autre structure extérieure parce qu’elles la jugeraient peu ou prou plus compétente, alors s’amorcerait de la perte progressive de leur autonomie.
Cette « cession » ou « concession » n’est en réalité qu’une acceptation d’une subtile domination du champ ou du domaine considéré. Elle est aussi l’acceptation de sa propre externalisation, une sorte d’auto-exclusion qui fait malheureusement fait écho à une attitude bien connue chez les africains du centre de l’Afrique : l’appétence pour ce qui est exogène (qui vient de l’Occident notamment) au détriment de ce qui relève du local.
Lorsqu’on considère la pratique des sciences sociales et humaines dans cette aire géographique, et plus largement à l’échelle du continent, on se rend compte qu’elle est larvée par ce rapport complexe qui a fini par constituer les uns en maîtres quasi absolu (détenteurs du dispositif) parce que mieux structurés, et les autres en obligés (locaux), parce que se contentant de « consommer » sans réserve. Une fois de plus, il ne s’agit pas ici d’inciter par la critique à la « création » de doublons des dispositifs scientifiques actuellement disponibles. Il ne s’agit pas non plus d’en faire des « labels » qui, affublés du qualificatif « africain », auraient pour mission de combler un vide réel sans tomber dans le piège d’une revanche à prendre contre les sciences coloniales ou les épistémès occidentales. Cette démarche, si elle devrait avoir lieu, s’emploierait au contraire à corriger avec la rigueur la plus absolue la dépendance du réalisme scientifique africain contemporain aux sciences externes pour enfin se poser en alternative plutôt fiable, au risque de s’opposer inutilement sans rien proposer de sérieux.
Ainsi cette situation qui doit interpeller à plus d’un titre semble au contraire s’installer. Les chercheurs africains tendent même à s’en accommoder. C’est en effet le défi qu’il convient de se lancer pour espérer sortir indemne de cette lutte que l’on sait d’avance très rude parce qu’elle oppose des parties dont les potentiels sont a priori inégalement répartis. Dans le même ordre d’idée, il est remarquable que toute tentative non occidentale de penser le monde en dehors des canons existant, provoque systématiquement levée de boucliers chez les tenants de l’orthodoxie scientifique et de la dépendance méthodologique. C’est d’ailleurs dans cette perspective que les études postcoloniales ont suscité contre elles des publications le plus souvent à charge. On peut, pour illustrer cette assertion, citer entre autre l’ouvrage de Jean-François Bayart (op. cit.).
Son texte souligne l’ambiguïté des études postcoloniales dont le développement colonise tous les champs du savoir. Au reste, Bayart y manifeste une sorte d’indignation, voire d’exaspération face aux productions qu’il considère comme un « nouvel avatar de l’atlantisme académique » (ibidem, p. 23). Le défi à relever est immense. La bataille pour une autonomie épistémologique autour d’une anthropologie africaine assumée s’annonce tout aussi âpre qu’épique, pour autant qu’on se donne objectivement les moyens de la relever.
3. L’anthropologie africaine assumée et ses horizons de quête
Les modèles méthodologiques et théoriques qui nous permettent, nous anthropologues africains subsahariens notamment, de penser le monde et précisément le nôtre, porte on le sait tous et ce dès les origines, une tare congénitale. Celle qui constitue l’Afrique noire francophone particulièrement, ainsi que l’indique Jean Copans dans la revue Ethnologie française, « […] comme paradigme fondateur des sciences sociales françaises et francophones du développement (1920-2010) » (2011, 405-414).
La « rencontre », ou si on le souhaite, la « découverte » des côtes africaines et plus largement du continent tout entier s’est faite, on peut le dire, sous le spectre de la constitution même de cette discipline. Ce qui n’est pas sans conséquence lorsqu’on observe sa trajectoire depuis lors (Sans revenir sur l’histoire et les débats connus de tous). Portant en elle les germes de leur improbable curabilité ontologique et épistémologique (J. Tonda, 2015, 201), les sciences sociales africaines et plus singulièrement l’anthropologie africaine souffrent [11] de ce qu’Achille Mbembe rend, dans son assai sur le discours africain de soi, par l’expression interminable incantation. Celle-ci se rapporte à peu près de la manière suivante : la doxa africaine est inlassablement hantée par trois spectres que sont l’esclavage, la colonisation et l’apartheid. Parce qu’il faut nécessairement des images capables de rendre compte de ces spectres, Mbembe propose l’idée de masques qui eux seraient la race, la géographie et la tradition.
Quoiqu’assigné de significations canoniques par ce qu’il nomme une « certaine intelligence », Mbembe considère que ces éléments constitutifs de la doxa africaine forment une sorte de prison dans laquelle aujourd’hui encore l’Afrique se débat. La possibilité d’une anthropologie « africaine » qui s’affranchisse de l’impérialisme épistémologique [12], en ce qu’elle doit rompre avec l’impérialisme postcolonial (J. Tonda, op. cit.) [13], trouve-là son fondement. Pierre Bourdieu (2012) reproche vertement d’ailleurs les « intellectuels français » d’avoir notamment « une arrogance insupportable pour la plupart des nation étrangères ». Car, rien n’est plus universel que la prétention à l’universel ou précisément à l’universalisation d’une vision du monde particulière. Ces deux impérialismes qui s’accommodent parfaitement et contre toute attente à la doctrine panafricaniste dont la visée serait de développer une certaine unité et solidarité [contre qui définitivement ?] africaines sont censés incarner cette anthropologie.
Il s’agit, dans cette perspective portant essentiellement sur une posture épistémologique, de postuler la possibilité de « l’impossible rupture des sciences sociales africaines d’avec les dispositifs de violences » propres aux impérialismes précités (J. Tonda, op. cit., p. 199 ; P. Bourdieu, op. cit.), et en l’occurrence, par la médiation du terrain africain comme espace d’expression d’une anthropologie africaine assumée. Mais envisager pareille perspective qui, on le sait, se heurte inéluctablement à de véritables murailles à la fois théoriques et méthodologiques, en vaut la peine. Car, si l’arsenal épistémologique en présence paraît redoutable, le terrain, comme le montre les travaux de Joseph Tonda (2002 ; 2005 et 2015) est l’un des sauf-conduits disponible et suffisamment capable d’offrir aux sciences sociales africaines, et singulièrement à l’anthropologie, un espace d’expression autonome et libre de tout ellipse théorique d’où qu’elle provienne. On aurait ainsi affaire à une Anthropologie de la transgression. Plus concrètement, comment envisager une telle anthropologie ?
On peut pour commencer considérer le dispositif de raisonnement scientifique disponible constitué notamment par les procédés dit de l’induction et de la déduction [14]. Ces deux procédés du reste reconnus par la communauté scientifique comme efficaces [15], et au regard de l’historiographie des sciences en générale, demeurent des idéaux. Ils le sont dans la mesure où aucun d’entre eux ne correspond à la réalité des pratiques scientifiques et des modalités de recherche en sociologie (comme dans toutes les autres sciences empiriques d’ailleurs). Il serait réducteur de croire que la démarche scientifique s’appuie nécessairement (et exclusivement) sur l’une ou l’autre de ces procédures (O. Martin, 2012, 13). De plus, nous l’avons signalé plus haut, toute pratique scientifique n’est, pour ainsi dire, jamais parfaitement neutre. Elle poursuit un but et elle se donne nécessairement les moyens de l’atteindre.
Cette dernière observation [16] peut en effet permettre d’envisager de perspectives nouvelles en matière de recherche et donc de production de savoirs. En l’occurrence ici, c’est sur le plan méthodologique et sur le terrain, donc en rapport avec les objets d’étude africains, que l’attention se porte pour caractériser des épistémès et des objets. Autrement dit, plutôt que de se contenter de « consommer » indéfiniment la pratique de la science à travers notamment le protocole scientifique mis à disposition ou prêt à l’emploi – par l’Occident –, les chercheurs africains devraient au contraire, tout en s’appuyant sur ce dernier, fonder leurs approches des objets scientifiques locaux sur la base de leurs spécificités. Si un effort n’est pas consenti dans ce sens, la question de l’autonomie des sciences et de leur pratique en Afrique demeurera toujours d’actualité, puisque inféodée à un dispositif dont elle ignore dans le fond les ressors et les objectifs.
Conclusion
L’idée d’une autre anthropologie qui sortirait des sentiers battus est en réalité possible. Du coup, oser proposer un abord des sciences sociales et humaine en s’appuyant sur des outils endogènes (un dispositif scientifique rigoureusement construit suivant les règles épistémologiques classiques), c’est non seulement s’affranchir de la tutelle intellectuelle, scientifique, économique mais également mentale.
Cet affranchissement n’est en réalité possible que grâce à une prise de conscience collective concrétisée par une volonté de « transgression » des règles établies sans consensus préalables afin d’en proposer d’autres, celles qui s’intègrent le mieux aux réalités locales qui les renseignent puisqu’informées des spécificités qui les fondent.
Mais on attend encore davantage de cette contribution. Nous espérons qu’elle gagnera à approfondir cette réflexion ailleurs, notamment en cherchant à saisir comment l’anthropologie de la transgression prend forme et se constitue progressivement en affirmant une identité dans l’analyse des significations sociales et anthropologiques expérimentées sur les terrains africains postcoloniaux. Il s’agira donc d’identifier les auteurs chez qui on peut prétendre voir se développer cette anthropologie transgressive contrainte par les recherches menées sur le terrain africain, de sorte qu’on puisse en interroger les concepts, les méthodologies et paradigmes, afin d’apprécier le niveau de pertinence de leur information par les sociétés et cultures qu’elle interroge.
Bibliographie
1. Ouvrages
Augé Marc, Herzlich Claudine (eds), Le sens du mal. Anthropologie, histoire, sociologie de la maladie,Paris, Edition des archives contemporaine, 1984.
Bayart Jean-François, Les études postcoloniales. Un carnaval académique, Paris, Karthala, 2010.
Godelier Maurice, La production des grands hommes : pouvoir et domination masculine chez les Baruya de Nouvelle-Guinée, Paris, Fayard, 1982.
Johannes Fabian, Le temps et les Autres. Comment l’Anthropologie construit son objet, Anarchiris, collection « Essai », 2006.
Le Petit Robert. Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, Rey A., Rey-Debove J. (dir.), Paris, Le Robert, 1990.
Popper Karl, Le réalisme et la science. La logique de la découverte scientifique, Paris, Hermann, 1990.
Tonda Joseph, L’impérialisme postcolonial. Critique de la société des éblouissements, Paris, Karthala (« Les Afriques »), 2015.
Tonda Joseph, La guérison divine en Afrique centrale, Paris, Karthala, 2002.
Tonda Joseph, Le souverain moderne. Le corps du pouvoir en Afrique centrale, Congo et Gabon, Paris, Karthala, 2005.
2. Articles
Bernault Florence , Tonda Joseph, « Le Gabon : une dystopie tropicale », in Politique africaine, n° 115, 2009.
Joubert Claire, « Théorie en traduction : Homi Bhabha et l’intervention postcoloniale », in Littérature, Paris, Armand Colin, 2009.
Mbembe Achille, « A propos des écritures africaines de soi », in Politique Africaine, 2000/4 (n° 77/1).
Tonda Joseph, « L’impossible décolonisation des sciences sociales africaines », in Mouvements, 2012/4 (n° 72).
Zecchini Laetitia, « Les études postcoloniales colonisent-elles les sciences sociales ? », in La vie des idées, 27 janvier 2011.
Pour citer cet article :
E. Faber Mensah Ngoma, « Epistémologie et transgression. Pour une anthropologie « africaine » assumée », Revue Oudjat en Ligne, numéro 2, volume 1, janvier 2019. Actes du colloque international de Librevillle, du 14 au 15 juin 2018.
ISBN : 978-2-912603-95-1.
[1] On peut, en retenant le concept de « postcolonial », noter que cette notion qui semble renvoyer à une période qui succèderait au régime spécial en vigueur dans les territoires sous domination occidentale englobe toutes les phases du processus colonial à nos jours. Du coup, les études postcoloniales postulent que les indépendances ne permettent pas et, de manière définitive, de faire oublier les effets ainsi que les traces de la domination coloniale. Et que celle-ci, selon l’approche bien connue de Foucault dans sa déclinaison « savoir-pouvoir », repose non seulement sur une infrastructure militaire mais aussi sur tout un appareil de savoir.
[2] Ce qui serait, de notre point de vue, non pas une utopie, mais davantage une dystopie, voire une afrodystopie, pour emprunter un concept cher à Tonda (F. Bernault, J. Tonda, 2009).
[3] Il s’agit d’une attitude qui tend très souvent à assimiler, à tort ou à raison, dans une même contemporanéité, les effets de la traite négrière, de colonialisme et ceux du néo-colonialisme. Toutes choses qui, même si elles ont parties liées, brouillent systématiquement toutes les analyses des faits sociaux, tant celle-ci tient à l’interminable entrelacement des époques (passée, présente et futur) des faits issus de la « rencontre » violente entre l’Europe et l’Afrique, en générale, et des visées de celle-ci, en particulier.
[4] Toute chose qui prend du sens dans l’analyse et l’interprétation du concept considéré, « Post », appliqué à l’histoire et la géographie de l’Afrique.
[5] A ce sujet, se reporter à l’issue du différend qui opposa la Côte d’Ivoire de Laurent Gbagbo à l’Etat français dans les années 2001/2002.
[6] Si le terme externalisé est emprunté volontiers au monde de l’entreprise parce qu’il renvoie à l’idée de sous-traitance (une entreprise, souvent de grande taille, confie à une entreprise de taille moyenne ou de petite taille, des tâches ou des activités qu’elle juge comme secondaires), ce terme prend un autre sens dans notre perspective. En effet, par externalisation nous entendons l’action de mettre en dehors de, d’exclure avec pour intention ultime le contrôle exclusif de l’espace, ou de l’objet considéré, en l’occurrence : la santé et de la maladie.
[7] Elle se rapporte à la pratique de la médecine, et applique tous les principes de la science naturelle dans la pratique clinique, en étudiant des processus physiopathologiques compte tenu des interactions moléculaires avec les processus dynamiques du corps à travers des méthodologies utilisées en biologie, chimie et physique.
[8] Cette réalité est de moins en moins évidente aujourd’hui, tant les autres formes d’offre de santé semblent s’être finalement imposées, et ce même, en dehors des limites de confinement où elles avaient été placées depuis la période coloniale. Certes le fond, en matière idéologique reste le même, mais on note la coexistence d’un réel panel de proposition de santé présenté aujourd’hui comme des médecines alternatives, homéopathique, complémentaires, traditionnelle chinoise, etc.
[9] En réalité il s’agit davantage d’une capitulation face au puissant dispositif biomédical.
[10] « Spécialiste thérapeutique » dont les pouvoirs sont fondés sur des entités invisibles spécifiques à une aire culturelle donnée généralement connu sous le nom de nganga. Ce « spécialiste » fonde sa légitimité sur la maîtrise des pratiques médicinales endogènes. Celles-ci sont doublées de prétendues connaissances médicales occidentales, à travers notamment l’écriture qui « apparaît ainsi comme le capital dont la possession transforme son détenteur en préposé légitime aux statuts et aux identités valorisés par le nouveau système de domination dont l’Etat fondé sur l’écriture est l’ordonnateur suprême » (J. Tonda, 2002, 106).
[11] Et peut-être pour une très longue période encore si de toute urgence rien n’est envisagé et posé de manière durable. Il est avéré que les réponses apportées à ce jour pour guérir cette « tare congénitale » n’ont rien produit de définitif en termes opératoires.
[12] Il s’agit d’un impérialisme culturel qui repose sur le pouvoir d’universaliser les particularismes liés à une tradition historique singulière en les faisant connaître comme tels.
[13] L’impérialisme postcolonial n’est pas l’impérialisme qui viendrait après la colonisation. Il est l’impérialisme noir, l’impérialisme invisible, de la Race ou de la Bête, c’est-à-dire de la valeur et de la libido, de l’Argent et du Sexe. Il est le point aveugle que partagent la théorie postcoloniale et ses contempteurs.
[14] L’induction correspond à un processus qui permet de passer du particulier (faits observés, cas singuliers, données expérimentales, situations) au général (une loi, une théorie, une connaissance générale). La déduction correspond au processus presque inverse qui permet de conclure (déduire) une affirmation à partir d’hypothèse, de prémisses ou d’un cadre théorique : les conclusions résultent formellement de ces prémisses ou de cette théorie (cf. K. Popper, 1990).
[15] Ces deux procédés de raisonnement ont, chacun pour leur part, contribué par le truchement de mécanismes spécifiques, à l’élaboration et à la production de savoirs plus ou moins fiables. Grâce à leurs dispositifs, nous sommes arrivés aux résultats que nous connaissons et qui, dans la plus part des cas, nous servent encore de cadres théoriques dans la construction et la production des savoirs.
[16] C’est à partir de cette brèche méthodologique et/ou épistémologique que nous entendons fonder la possibilité de mettre en avant la pratique d’une anthropologie africaine qui soit totalement décloisonnée, fût-ce-t-elle principalement (mais pas seulement) sur l’un ou l’autre de ces deux aspects.
ACCUEIL » PUBLICATIONS » ANCIENS NUMEROS » Les post- et les anthropologies en Afrique. Du dialogue sud/nord, numéro 2, volume 1, janvier 2019. Actes du colloque international de Libreville, du 14 au 15 juin 2018 » Articles de ce numéro
AN = Epistémologie et transgression.E. Faber Mensah Ngoma,
Il n’est donc pas question ici – et c’est important de le signaler car la tentation est en règle générale souvent très grande – de créer un doublon de la discipline du simple fait de l’adjonction du qualificatif « africaine » qui constituerait une sorte de « label », mais un « label » plutôt vide puisque n’apportant rien de nouveau ni aux débats actuels, ni à la pratique de la discipline elle-même. D’autre part, on se préoccupe d’éviter d’être tenté et hanté tous azimuts par les « démons » d’un supposé affranchissement épistémologique parce que profondément déterminé par un relent revanchard [3]. Cette contribution, au contraire, se pose en alternative objectivement fondée, susceptible de « corriger » de manière constructive (dans l’opposition et la concession si nécessaire), ce qu’elle considère comme étant des erreurs, voire des errances d’une certaine « anthropologie universaliste ». Son idée centrale est donc de considérer la spécificité (dans le présent cas, le terrain africain en général, et celui d’Afrique centrale en particulier), non plus comme une exception dénuée de toute capacité à offrir du sens dans un ensemble plus vaste puisque spécifique et idéologiquement assignée, mais plutôt d’intégrer la singularité anthropologique africaine dans une étendue des connaissances plus large parce qu’en réalité, elle en est consubstantielle. Comment en effet penser l’espace et le temps d’une société, ou plus largement comment envisager l’histoire et l’avenir d’un espace social donné en dehors de celui-ci ? Si l’objet de la présente contribution n’est pas de répondre précisément et prioritairement à cette interrogation mais plutôt d’envisager la possibilité d’une autre anthropologie africaine, il reste qu’au XXIe siècle, et au regard des dynamiques de changement qui s’opèrent à vitesse grand « V », cette problématique a le mérite d’être posée ne serait-ce que pour susciter le débat. Notre réflexion portera sur les concepts en jeu, les éléments de base constitutifs d’une réflexion sur une anthropologie africaine assumée et ses fondements épistémologiques.
Avant de poursuivre plus en profondeur cette discussion autour de la question essentielle du « terrain africain comme lieu d’expression d’une anthropologie africaine assumée », il nous paraît opportun de revenir sur la définition, sinon le sens de deux concepts qui surdéterminent le titre cette contribution. Celui de « transgression » d’une part et celui de « post » de l’autre (l’ordre revêt peu d’importance). S’il est vrai que dans cette analyse l’usage de la notion de « transgression » adopte volontiers une posture, cette notion parce qu’elle est centrale dans le dispositif d’ordonnancement social, est davantage « porteuse » de sens qu’il n’y paraît. Considérée comme l’action de transgresser, c’est-à-dire de ne pas respecter une loi, un ordre ou un interdit par la plupart des dictionnaires disponibles, la définition d’un autre concept l’incluant proposée par Le Petit Robert (1990) permet en revanche d’en éclairer le sens, et partant d’en justifier les raisons de son choix. Il s’agit en effet du concept de déviance. La déviance, nous dit Le Petit Robert, est un mot d’usage très récent (les années 1960) qui, dans son sens psychologique, signifie « comportement qui échappe aux règles admises par la société ». Plus précisément, est considéré comme « déviant(e) », toute personne dont le comportement s’écarte de la norme sociale admise. Ainsi, pour qu’une situation de déviance soit admise comme telle, il faut nécessairement que soient réunis trois éléments constitutifs de celle-ci. Il s’agit de :
Tout l’intérêt de la notion de « transgression », dans notre réflexion, réside finalement dans l’encadrement dont elle fait explicitement l’objet. La norme, conçue pour régir le social ne peut se concevoir en dehors de la transgression. On s’en rend donc compte, cette norme porte en elle, dès les origines, le germe même de la transgression, donc du risque de sa remise en cause. Si la norme, et en l’occurrence la norme sociale, est indispensable pour une société, la nécessaire transgression qui n’est pas une apologie de l’anarchie ou du chaos l’anticipe finalement. C’est parce que la norme est, dans la plupart des cas, idéologiquement marquée qu’elle porte en elle les germes de sa propre dérive. La transgression apparaît de ce point de vue comme un rempart. Ce n’est donc pas surprenant qu’en se posant comme la garante d’un certain ordre social, la norme se prémunie d’un dispositif censé juguler toute action de transgression notamment par un processus efficace de stigmatisation. Sans chercher à davantage s’étendre sur le développement des arguments évoqués et se rapportant à la notion de transgression, signalons encore que, de même que la société procède par la norme et donc par son respect pour assurer son bon fonctionnement, la science qui n’est pas idéologiquement neutre en fait autant. Ainsi, la « transgression » méthodologique, théorique et épistémologique apparaît en définitive comme un rempart sûr à l’expression idéologique, à l’unilatéralisme scientifique et à l’offre épistémologique disponible. Notre titre ne porte pas une posture sarcastique mais scientifique. Dans ces conditions, on le sait, il ne peut être exempt de perspective idéologique d’autant que l’idée de neutralité dans la pratique scientifique est davantage un projet qu’une réalité. En outre, pour Le Petit Robert (op. cit.), le terme « Post », tiré du latin, est littéralement rendu par l’adverbe de temps et de lieu [4] « après » (précision non fortuite) pour signifier aussi bien le temps et l’espace. Pour notre part, cette notion de « Post » se réfère davantage à l’idée du moment postcolonial tel qu’envisagée par les études postcoloniales, c’est-à-dire dans une double assertion. Il s’agit donc d’une part, de considérer la période qui succède au moment colonial et dont les indépendances constituent en quelque sorte la charnière et, d’autre part, de considérer ce concept de « Post » comme l’ensemble des faits qui procèdent du fait colonial et dont les effets demeurent perceptibles jusqu’à nos jours. Cette perspective dépasse la définition du Petit Robert qui elle ne retient du terme « Post » que les seuls aspects de lieu et de temps. En revanche, elle fait écho aux propos d’Homi Bhabha. Pour lui, la notion ne recouvre aucunement la séquentialité (après le colonial) ou la polarité (anti-colonial), à tout le moins, pas exclusivement. Notre approche doit ainsi prendre en compte toutes les phases du processus colonial qui jusqu’à date font sens. Comme l’indique fort brillamment Laetitia Zecchini en réponse justement à l’ouvrage au titre révélateur de Jean-François Bayart paru chez Karthala (2010), « Les études postcoloniales postulent que l’indépendance ne suffit pas à occulter les traces de la domination coloniale et que celle-ci, selon l’articulation foucaldienne savoir-pouvoir, reposait certes sur une infrastructure militaire mais aussi sur tout un appareil de savoir. C’est donc l’analyse discursive, le décentrement et la déterritorialisation des discours, mais aussi leur « « revers », ce qui s’y dérobe, s’y joue et s’y pluralise qui est en jeu » (2011, 27). En toile de fond, cette idée de domination dans les rapports « nord-sud » va structurer la présente communication.
Deux exemples tirés de situations différentes peuvent permettre d’illustrer l’idée du risque épistémologique à prendre corrélativement à la pratique des sciences humaines et sociales en Afrique. Le premier exemple, nous le tirons du monde militaire. Imaginons un Etat nouvellement indépendant. La sécurité à l’intérieur et à l’extérieur de ses frontières est en règle générale l’un des ses premiers chantiers. C’est donc à ce titre qu’il se tournera vers un Etat (ancienne puissance dominatrice ou non) militairement reconnu pour structurer son armée (formation des troupes, des sous-officiers et officiers, en usage et maniement des armes et munitions, des équipements etc.). Ainsi, la défense du territoire national, comme la sécurité intérieure du nouvel Etat, repose exclusivement sur un dispositif (des logiques et des équipements) qui leur sont totalement extérieurs, puisque mises au point par une puissance dont il reconnaît en définitive l’expertise. Dans le même ordre d’idée, comment imaginer la propre défense intérieure de ce même Etat, s’il venait à surgir un différend de quelle que nature que ce soit qui l’opposerait à son ancienne puissance formatrice ; différend si insurmontable de telle sorte que seul le conflit armé en soit l’unique solution de continuité ? Dans tous les cas et dans la mesure où la logique militaire, la formation des troupes, le dispositif opérationnel (armes munitions et matériels motorisés, etc.) demeurent l’apanage exclusif de cette dernière puissance, l’issue ne fera aucun doute. C’est la puissance devenue tutélaire par la force des choses qui aura nécessairement et malheureusement l’ascendant et donc le dernier mot, car maîtrisant à la perfection tous les éléments non seulement du dispositif armé, mais également les logiques et la technologie qui les sous-tendent et en organisent les dispositifs [5]. Le deuxième exemple tiré du domaine biomédical nous plonge dans un processus subtil mais très efficace d’externalisation [6], voire d’exclusion stricte des structures des « savoirs locaux » du champ et des objets de santé. En effet, à travers la mise en place d’un dispositif à la fois verrouillé – de bout en bout – et hautement sophistiqué, l’ordre biomédical s’assure une gestion exclusive de l’événement-maladie, quand bien même celui-ci se manifeste en dehors de son univers sociogéographique. Si l’ordre des médecins présenté comme étant une structure professionnelle, administrative et juridique veille à la défense et la régulation de la profession médicale, ses différentes missions ne s’exercent en revanche qu’à l’intérieur d’un environnement exclusif, avec des règles qui ne s’appliquent qu’à ceux qui y font partie et qui ont préalablement rempli des critères bien définis : il s’agit de la seule biomédecine [7]. Notons ce fait important : dans cette organisation [8], en dehors de cette sphère singulière, toute autre structure (médecine africain par exemple), bien que prenant en charge elle aussi l’événement-maladie, ne peut être considérée comme pertinente. Elle peut tout juste être tolérée. Devant la puissance d’un tel arsenal dont la puissance est tout à la fois structurelle, financière, technique et technologique, l’issue du face à face ne fait aucun doute. On assiste simplement à l’adhésion [9], sans autres formes de procès, à l’offre biomédicale finalement « imposée ». La principale conséquence d’une telle capitulation, lorsqu’on considère les éléments constitutifs du dispositif mis en place (formation, structure de formation, les moyens dégagés les techniques et technologies proposé), est comme on l’a vu pour le premier exemple, la subordination quasi-totale des structures locales chargée de la gestion de l’événement-maladie, aussi bien aux dispositifs biomédicales qu’aux logiques que ceux-ci sous-tendent. Pour mieux rendre compte de cet assujettissement des structure thérapeutiques locales aux structures biomédicales, observons leur comportement : n’assiste-t-on pas impuissant à une sorte de syncrétisme tous azimuts dans ce domaine particulier, comme c’est d’ailleurs le cas en ce qui concerne la religion ? Le nganga [10], tirant d’ailleurs et de plus en plus sa légitimité de la maîtrise de l’écriture, privilégie le port de la blouse blanche et l’usage et la technique du stéthoscope ou du tensiomètre, tente de ressembler à son homologue de la biomédecine. On pourrait rétorquer avec R. Devisch que ces structures locales se réapproprient, sous un mode ironiquement mimétique, certaines formes de violences caractéristiques du système de pouvoir, du discours et des symboles de base de l’époque coloniale ou postcoloniale ; et qu’ainsi elles renouent en même temps de façon créatrice avec les configurations culturelles ancestrales, signe d’une aspiration à un affranchissement, à une libération à l’égard des modèles chrétiens qui inventent un ordre social et culturel tout à fait « nouveau » (1996, 91). Le fait est que ces structures locales restent, et peut-être même pour un bon moment encore, soumises, ne serait-ce qu’à travers ces images qu’elles se réapproprient, aux règles de fonctionnement du dispositif ainsi mimé. Or, on le voit bien, en intégrant des éléments techniques et technologiques du dispositif biomédical dans les dispositifs locaux de prise en en charge de la maladie, ce ne sont pas que des techniques et des technologies qui sont réinterprétées, c’est d’abord et avant tout des logiques de fonctionnements exogènes qui sont intégrées au cœur même du dispositif local. De ce point de vue, comment espérer continuer à détenir le contrôle de la gestion de l’événement-maladie ? Rappelons qu’il est de notoriété que les systèmes d’interprétation, évidemment manié par des spécialistes (nganga entre autres) mais connus ou à tout le moins reconnus de tous, font en effet de tout désordre biologique (survenue d’un dysfonctionnement physiologique ou psychiatrique), le signe d’un désordre social tel que l’agression en sorcellerie, l’adultère ou la rupture d’un interdit. Et que par ailleurs, une même logique intellectuelle commande la mise en ordre biologique et la mise en ordre sociale. Ce qui revient à dire que dans une société donnée, une seule grille d’interprétation du monde s’applique tout autant au corps individuel qu’aux institutions sociales. Autrement dit, si logique il y a, elle est celle-là même dont procèdent simultanément la constitution du corps et l’institution du social (M. Augé, 2009, 35 - 36). Toute chose qui perd tout son sens dès lors que les logiques qui fondent le dispositif local de prise en charge de l’événement-maladie se diluent dans celles qu’elles intègrent par mimétisme ou par syncrétisme. Comment dans ce cas imaginer une autonomisation réelle de structures locales si celles-ci sont noyées, phagocytés par des structures ayant une organisation extrêmement forte et donc redoutable ? C’est dans cette perspective que s’exprime ce que nous avons précédemment nommé externalisation des structures de « savoirs locaux » de leur champ et des objets qu’ils renferment (société, santé, maladie et médecine). En effet, comment penser le local, en l’occurrence, l’objet maladie et son corollaire social avec des outils qui lui sont totalement extérieurs, et espérer en avoir la totale maîtrise ? Poser cette interrogation, c’est en partie y répondre. Car en l’état, qu’il s’agisse de prise en charge purement thérapeutique ou encore des études sur les objets se référant à la maladie, à la médecine ou plus globalement à la santé en Afrique, et singulièrement en Afrique centrale, les dispositifs mobilisés, à l’exception de cas très marginaux, sont dans leur essence de même nature que les pratiques exclusivement extérieures au continent. Ces exemples tirés de domaines différents (armée et santé) ont partie liée au fait que des enjeux complexes de pouvoir qui s’y déroulent renseignent fortement sur les risques et les conséquences encourus par toute « structure locale » ayant à charge la gestion d’une ou plusieurs parcelles de souveraineté. En effet si les structures locales devaient, pour des raisons d’efficacité ou d’opérationnalité, céder ou concéder à un moment ou à une autre leur fonctionnement à toute autre structure extérieure parce qu’elles la jugeraient peu ou prou plus compétente, alors s’amorcerait de la perte progressive de leur autonomie. Cette « cession » ou « concession » n’est en réalité qu’une acceptation d’une subtile domination du champ ou du domaine considéré. Elle est aussi l’acceptation de sa propre externalisation, une sorte d’auto-exclusion qui fait malheureusement fait écho à une attitude bien connue chez les africains du centre de l’Afrique : l’appétence pour ce qui est exogène (qui vient de l’Occident notamment) au détriment de ce qui relève du local. Lorsqu’on considère la pratique des sciences sociales et humaines dans cette aire géographique, et plus largement à l’échelle du continent, on se rend compte qu’elle est larvée par ce rapport complexe qui a fini par constituer les uns en maîtres quasi absolu (détenteurs du dispositif) parce que mieux structurés, et les autres en obligés (locaux), parce que se contentant de « consommer » sans réserve. Une fois de plus, il ne s’agit pas ici d’inciter par la critique à la « création » de doublons des dispositifs scientifiques actuellement disponibles. Il ne s’agit pas non plus d’en faire des « labels » qui, affublés du qualificatif « africain », auraient pour mission de combler un vide réel sans tomber dans le piège d’une revanche à prendre contre les sciences coloniales ou les épistémès occidentales. Cette démarche, si elle devrait avoir lieu, s’emploierait au contraire à corriger avec la rigueur la plus absolue la dépendance du réalisme scientifique africain contemporain aux sciences externes pour enfin se poser en alternative plutôt fiable, au risque de s’opposer inutilement sans rien proposer de sérieux. Ainsi cette situation qui doit interpeller à plus d’un titre semble au contraire s’installer. Les chercheurs africains tendent même à s’en accommoder. C’est en effet le défi qu’il convient de se lancer pour espérer sortir indemne de cette lutte que l’on sait d’avance très rude parce qu’elle oppose des parties dont les potentiels sont a priori inégalement répartis. Dans le même ordre d’idée, il est remarquable que toute tentative non occidentale de penser le monde en dehors des canons existant, provoque systématiquement levée de boucliers chez les tenants de l’orthodoxie scientifique et de la dépendance méthodologique. C’est d’ailleurs dans cette perspective que les études postcoloniales ont suscité contre elles des publications le plus souvent à charge. On peut, pour illustrer cette assertion, citer entre autre l’ouvrage de Jean-François Bayart (op. cit.). Son texte souligne l’ambiguïté des études postcoloniales dont le développement colonise tous les champs du savoir. Au reste, Bayart y manifeste une sorte d’indignation, voire d’exaspération face aux productions qu’il considère comme un « nouvel avatar de l’atlantisme académique » (ibidem, p. 23). Le défi à relever est immense. La bataille pour une autonomie épistémologique autour d’une anthropologie africaine assumée s’annonce tout aussi âpre qu’épique, pour autant qu’on se donne objectivement les moyens de la relever.
Les modèles méthodologiques et théoriques qui nous permettent, nous anthropologues africains subsahariens notamment, de penser le monde et précisément le nôtre, porte on le sait tous et ce dès les origines, une tare congénitale. Celle qui constitue l’Afrique noire francophone particulièrement, ainsi que l’indique Jean Copans dans la revue Ethnologie française, « […] comme paradigme fondateur des sciences sociales françaises et francophones du développement (1920-2010) » (2011, 405-414). La « rencontre », ou si on le souhaite, la « découverte » des côtes africaines et plus largement du continent tout entier s’est faite, on peut le dire, sous le spectre de la constitution même de cette discipline. Ce qui n’est pas sans conséquence lorsqu’on observe sa trajectoire depuis lors (Sans revenir sur l’histoire et les débats connus de tous). Portant en elle les germes de leur improbable curabilité ontologique et épistémologique (J. Tonda, 2015, 201), les sciences sociales africaines et plus singulièrement l’anthropologie africaine souffrent [11] de ce qu’Achille Mbembe rend, dans son assai sur le discours africain de soi, par l’expression interminable incantation. Celle-ci se rapporte à peu près de la manière suivante : la doxa africaine est inlassablement hantée par trois spectres que sont l’esclavage, la colonisation et l’apartheid. Parce qu’il faut nécessairement des images capables de rendre compte de ces spectres, Mbembe propose l’idée de masques qui eux seraient la race, la géographie et la tradition. Quoiqu’assigné de significations canoniques par ce qu’il nomme une « certaine intelligence », Mbembe considère que ces éléments constitutifs de la doxa africaine forment une sorte de prison dans laquelle aujourd’hui encore l’Afrique se débat. La possibilité d’une anthropologie « africaine » qui s’affranchisse de l’impérialisme épistémologique [12], en ce qu’elle doit rompre avec l’impérialisme postcolonial (J. Tonda, op. cit.) [13], trouve-là son fondement. Pierre Bourdieu (2012) reproche vertement d’ailleurs les « intellectuels français » d’avoir notamment « une arrogance insupportable pour la plupart des nation étrangères ». Car, rien n’est plus universel que la prétention à l’universel ou précisément à l’universalisation d’une vision du monde particulière. Ces deux impérialismes qui s’accommodent parfaitement et contre toute attente à la doctrine panafricaniste dont la visée serait de développer une certaine unité et solidarité [contre qui définitivement ?] africaines sont censés incarner cette anthropologie. Il s’agit, dans cette perspective portant essentiellement sur une posture épistémologique, de postuler la possibilité de « l’impossible rupture des sciences sociales africaines d’avec les dispositifs de violences » propres aux impérialismes précités (J. Tonda, op. cit., p. 199 ; P. Bourdieu, op. cit.), et en l’occurrence, par la médiation du terrain africain comme espace d’expression d’une anthropologie africaine assumée. Mais envisager pareille perspective qui, on le sait, se heurte inéluctablement à de véritables murailles à la fois théoriques et méthodologiques, en vaut la peine. Car, si l’arsenal épistémologique en présence paraît redoutable, le terrain, comme le montre les travaux de Joseph Tonda (2002 ; 2005 et 2015) est l’un des sauf-conduits disponible et suffisamment capable d’offrir aux sciences sociales africaines, et singulièrement à l’anthropologie, un espace d’expression autonome et libre de tout ellipse théorique d’où qu’elle provienne. On aurait ainsi affaire à une Anthropologie de la transgression. Plus concrètement, comment envisager une telle anthropologie ? On peut pour commencer considérer le dispositif de raisonnement scientifique disponible constitué notamment par les procédés dit de l’induction et de la déduction [14]. Ces deux procédés du reste reconnus par la communauté scientifique comme efficaces [15], et au regard de l’historiographie des sciences en générale, demeurent des idéaux. Ils le sont dans la mesure où aucun d’entre eux ne correspond à la réalité des pratiques scientifiques et des modalités de recherche en sociologie (comme dans toutes les autres sciences empiriques d’ailleurs). Il serait réducteur de croire que la démarche scientifique s’appuie nécessairement (et exclusivement) sur l’une ou l’autre de ces procédures (O. Martin, 2012, 13). De plus, nous l’avons signalé plus haut, toute pratique scientifique n’est, pour ainsi dire, jamais parfaitement neutre. Elle poursuit un but et elle se donne nécessairement les moyens de l’atteindre. Cette dernière observation [16] peut en effet permettre d’envisager de perspectives nouvelles en matière de recherche et donc de production de savoirs. En l’occurrence ici, c’est sur le plan méthodologique et sur le terrain, donc en rapport avec les objets d’étude africains, que l’attention se porte pour caractériser des épistémès et des objets. Autrement dit, plutôt que de se contenter de « consommer » indéfiniment la pratique de la science à travers notamment le protocole scientifique mis à disposition ou prêt à l’emploi – par l’Occident –, les chercheurs africains devraient au contraire, tout en s’appuyant sur ce dernier, fonder leurs approches des objets scientifiques locaux sur la base de leurs spécificités. Si un effort n’est pas consenti dans ce sens, la question de l’autonomie des sciences et de leur pratique en Afrique demeurera toujours d’actualité, puisque inféodée à un dispositif dont elle ignore dans le fond les ressors et les objectifs.
L’idée d’une autre anthropologie qui sortirait des sentiers battus est en réalité possible. Du coup, oser proposer un abord des sciences sociales et humaine en s’appuyant sur des outils endogènes (un dispositif scientifique rigoureusement construit suivant les règles épistémologiques classiques), c’est non seulement s’affranchir de la tutelle intellectuelle, scientifique, économique mais également mentale. Cet affranchissement n’est en réalité possible que grâce à une prise de conscience collective concrétisée par une volonté de « transgression » des règles établies sans consensus préalables afin d’en proposer d’autres, celles qui s’intègrent le mieux aux réalités locales qui les renseignent puisqu’informées des spécificités qui les fondent. Mais on attend encore davantage de cette contribution. Nous espérons qu’elle gagnera à approfondir cette réflexion ailleurs, notamment en cherchant à saisir comment l’anthropologie de la transgression prend forme et se constitue progressivement en affirmant une identité dans l’analyse des significations sociales et anthropologiques expérimentées sur les terrains africains postcoloniaux. Il s’agira donc d’identifier les auteurs chez qui on peut prétendre voir se développer cette anthropologie transgressive contrainte par les recherches menées sur le terrain africain, de sorte qu’on puisse en interroger les concepts, les méthodologies et paradigmes, afin d’apprécier le niveau de pertinence de leur information par les sociétés et cultures qu’elle interroge.
1. Ouvrages 2. Articles
ISBN : 978-2-912603-95-1. |
|
[1] On peut, en retenant le concept de « postcolonial », noter que cette notion qui semble renvoyer à une période qui succèderait au régime spécial en vigueur dans les territoires sous domination occidentale englobe toutes les phases du processus colonial à nos jours. Du coup, les études postcoloniales postulent que les indépendances ne permettent pas et, de manière définitive, de faire oublier les effets ainsi que les traces de la domination coloniale. Et que celle-ci, selon l’approche bien connue de Foucault dans sa déclinaison « savoir-pouvoir », repose non seulement sur une infrastructure militaire mais aussi sur tout un appareil de savoir. [2] Ce qui serait, de notre point de vue, non pas une utopie, mais davantage une dystopie, voire une afrodystopie, pour emprunter un concept cher à Tonda (F. Bernault, J. Tonda, 2009). [3] Il s’agit d’une attitude qui tend très souvent à assimiler, à tort ou à raison, dans une même contemporanéité, les effets de la traite négrière, de colonialisme et ceux du néo-colonialisme. Toutes choses qui, même si elles ont parties liées, brouillent systématiquement toutes les analyses des faits sociaux, tant celle-ci tient à l’interminable entrelacement des époques (passée, présente et futur) des faits issus de la « rencontre » violente entre l’Europe et l’Afrique, en générale, et des visées de celle-ci, en particulier. [4] Toute chose qui prend du sens dans l’analyse et l’interprétation du concept considéré, « Post », appliqué à l’histoire et la géographie de l’Afrique. [5] A ce sujet, se reporter à l’issue du différend qui opposa la Côte d’Ivoire de Laurent Gbagbo à l’Etat français dans les années 2001/2002. [6] Si le terme externalisé est emprunté volontiers au monde de l’entreprise parce qu’il renvoie à l’idée de sous-traitance (une entreprise, souvent de grande taille, confie à une entreprise de taille moyenne ou de petite taille, des tâches ou des activités qu’elle juge comme secondaires), ce terme prend un autre sens dans notre perspective. En effet, par externalisation nous entendons l’action de mettre en dehors de, d’exclure avec pour intention ultime le contrôle exclusif de l’espace, ou de l’objet considéré, en l’occurrence : la santé et de la maladie. [7] Elle se rapporte à la pratique de la médecine, et applique tous les principes de la science naturelle dans la pratique clinique, en étudiant des processus physiopathologiques compte tenu des interactions moléculaires avec les processus dynamiques du corps à travers des méthodologies utilisées en biologie, chimie et physique. [8] Cette réalité est de moins en moins évidente aujourd’hui, tant les autres formes d’offre de santé semblent s’être finalement imposées, et ce même, en dehors des limites de confinement où elles avaient été placées depuis la période coloniale. Certes le fond, en matière idéologique reste le même, mais on note la coexistence d’un réel panel de proposition de santé présenté aujourd’hui comme des médecines alternatives, homéopathique, complémentaires, traditionnelle chinoise, etc. [9] En réalité il s’agit davantage d’une capitulation face au puissant dispositif biomédical. [10] « Spécialiste thérapeutique » dont les pouvoirs sont fondés sur des entités invisibles spécifiques à une aire culturelle donnée généralement connu sous le nom de nganga. Ce « spécialiste » fonde sa légitimité sur la maîtrise des pratiques médicinales endogènes. Celles-ci sont doublées de prétendues connaissances médicales occidentales, à travers notamment l’écriture qui « apparaît ainsi comme le capital dont la possession transforme son détenteur en préposé légitime aux statuts et aux identités valorisés par le nouveau système de domination dont l’Etat fondé sur l’écriture est l’ordonnateur suprême » (J. Tonda, 2002, 106). [11] Et peut-être pour une très longue période encore si de toute urgence rien n’est envisagé et posé de manière durable. Il est avéré que les réponses apportées à ce jour pour guérir cette « tare congénitale » n’ont rien produit de définitif en termes opératoires. [12] Il s’agit d’un impérialisme culturel qui repose sur le pouvoir d’universaliser les particularismes liés à une tradition historique singulière en les faisant connaître comme tels. [13] L’impérialisme postcolonial n’est pas l’impérialisme qui viendrait après la colonisation. Il est l’impérialisme noir, l’impérialisme invisible, de la Race ou de la Bête, c’est-à-dire de la valeur et de la libido, de l’Argent et du Sexe. Il est le point aveugle que partagent la théorie postcoloniale et ses contempteurs. [14] L’induction correspond à un processus qui permet de passer du particulier (faits observés, cas singuliers, données expérimentales, situations) au général (une loi, une théorie, une connaissance générale). La déduction correspond au processus presque inverse qui permet de conclure (déduire) une affirmation à partir d’hypothèse, de prémisses ou d’un cadre théorique : les conclusions résultent formellement de ces prémisses ou de cette théorie (cf. K. Popper, 1990). [15] Ces deux procédés de raisonnement ont, chacun pour leur part, contribué par le truchement de mécanismes spécifiques, à l’élaboration et à la production de savoirs plus ou moins fiables. Grâce à leurs dispositifs, nous sommes arrivés aux résultats que nous connaissons et qui, dans la plus part des cas, nous servent encore de cadres théoriques dans la construction et la production des savoirs. [16] C’est à partir de cette brèche méthodologique et/ou épistémologique que nous entendons fonder la possibilité de mettre en avant la pratique d’une anthropologie africaine qui soit totalement décloisonnée, fût-ce-t-elle principalement (mais pas seulement) sur l’un ou l’autre de ces deux aspects. |

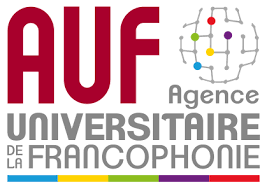
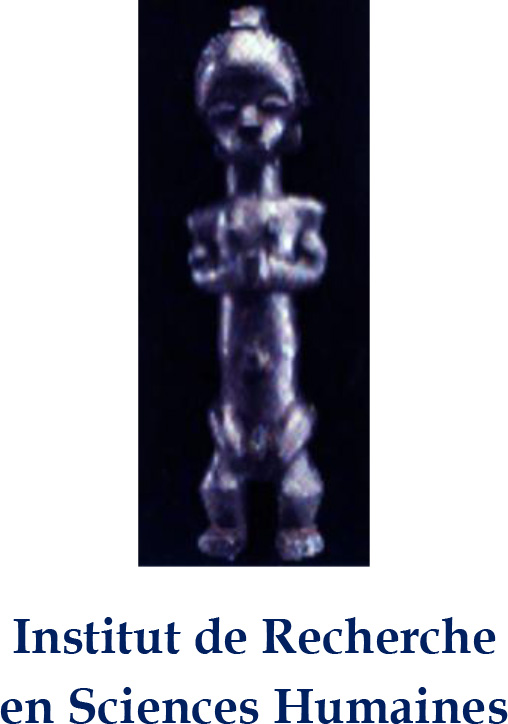 la penser ensemble...
la penser ensemble...